GESTION DES HORTILLONNAGES...

Introduction
A la fin du XXème, dans les années 1980 et suivantes,
à suivre
ARCHIVES
Rapport de la DDE de la Somme
Amiens. Les Hortillonnages - Document reprographié de la D.D.E. 80 /G.E.P., 50 p.
I – Présentation du milieu physique
1. Origine et situation :
Au cours des millénaires le fleuve Somme a creusé dans le calcaire du plateau picard le large sillon d’une vallée à fond plat. Il y déroule ses méandres jusqu’à la mer, à la fois rivière, étangs et marais. C’est en amont d’Amiens, que ces marais investis par l’homme forment les hortillonnages .
D’est en ouest, de la route de Camon à Longueau jusqu’au Pont Beauvillé, ils s’étalent sur plus de 4 kilomètres en pénétrant ainsi jusqu’au cœur d’Amiens .
Leur origine est ancienne, mais incertaine : on raconte que les Romains nommaient déjà « hortillons » (du latin hortus : jardin) ceux qui travaillaient ces jardins curieux. C’est probablement au Moyen Age (grâce au développement des techniques de drainage et de protection contre les eaux que Hollandais ont pu faire connaître (hypothèse)), au prix d’un travail opiniâtre et d’une lutte permanente de l’homme contre ce milieu aquatique que les hortillonnages prirent l’aspect qu’on leur connaît en partie aujourd’hui.
2. Caractéristiques morphologiques et pédologiques du milieu :
Sur 250 hectares, la terre et l’eau s’interpénètrent.
a) Les hortillonnages se présentent comme une mosaïque de petites parcelles de terre appelées « aires », de taille variable (de 200 à 4000 m2), séparées les unes des autres par une multitude de fossés et canaux formant un maillage très dense et servant à assurer aussi bien leur desserte qu’à les drainer et les irriguer.
Cette organisation du parcellaire en « lames de parquet » est imposée par les caractéristiques pédologiques et hydrauliques du milieu. Une largeur de parcelle de 30 à 40 m est un optimum pour que le drainage de la parcelle s’effectue efficacement.
Constamment érodées par l’eau en particulier, les aires doivent régulièrement être exhaussées, grâce à l’apport de boues issues du curage des fossés.
De même, les berges des parcelles doivent elles être périodiquement refaçonnées selon une technique dite à « à l’ancienne » (terre compactée). De plus en plus, surtout dans les zones de loisirs, elles sont constituées de pieux de bois, de plaques de tôle ou de béton.
L’envasement de ces fossés et rieux provoquerait à terme la disparition des hortillonnages, l’irrigation des sols ne se ferait plus, le relèvement des terrains deviendrait impossible, les risques d’inondations seraient à redouter.
Ponctuellement, des plans d’eau issus de l’extraction de la tourbe, interrompent cette structure parcellaire. Au total, les surfaces en eau représentent plus du tiers de la superficie du site.
b) Les sols tourbeux, recouverts d’alluvions sont très riches en matière organique et en éléments minéraux. Régulièrement engraissés par l’apport de vases extraites lors du curage des fossés et rieux, ils sont très fertiles.
3. L’eau :
Organisés de part et d’autre de la Somme et de son affluent l’Avre, les hortillonnages sont sillonnés de multiples canaux, les rieux (17 km au total, de largeur variable 2 à 6 m) qui assurent l’écoulement des eaux. Au contraire, dans les fossés plus étroits, l’écoulement est pratiquement toujours nul.
L’inter-relation des rieux avec la Somme est telle que toute variation de son niveau a systématiquement des répercussions sur celui des eaux dans les hortillonnages. Ces fluctuations peuvent perturber la circulation sur les rieux, et provoquer l’inondation de certaines terres .
La complexité des phénomènes hydrauliques rend difficile leur maîtrise en cet endroit (Cf. étude de P. LE MORVAN, nov. 1979 et janvier 1983).
Une chose est sûre :
Le maintien de l’écoulement de l’eau dans les rieux est vital pour les hortillonnages.
Leur entretien régulier (faucardage et curage) est une nécessité constante puisqu’ils servent également de voie de circulation, permettant d’accéder aux parcelles.
1. L’écosystème des hortillonnages :
Les hortillonnages abritent un grand nombre d’espèces végétales et animales groupées en une multitude d’associations dont la productivité biologique supplante notablement celle des milieux plus homogènes et banalisés.
Au point de vue zoologique, plus que la quantité d’individus, c’est le nombre d’espèces recensées liées au biotope qui peut établir la richesse de celui-ci. 84 espèces d’oiseaux ont pu être recensées. La composition de cette avifaune fait apparaître une triple influence urbaine, bocagère et paludéenne. On compte également 13 espèces de mammifères et 17 espèces de poissons sans compter la microfaune insuffisamment étudiée jusqu’ici.
Du point de vue botanique, on relève bien sûr la flore typique des marais, mais plus généralement un mélange particulier de flore spontanée, sub-spontanée et cultivée. Il existe en effet un éventail complet de formations végétales depuis les terres cultivées jusqu’au climax (dans les terres abandonnées depuis longtemps : aulnaie sur sol couvert de lierre) en passant par les plantes « pionnières » et la suite du cortège floristique.
Cette richesse écologique relative est essentiellement due à l’important « effet écologique de lisière » (limite entre deux milieux différents, zone d‘échanges privilégiés) dont les hortillonnages sont globalement le siège.
Carte : L’espace maraîcher actuel : 4 secteurs : « le Malaquis » à l’ouest, « Rue de Verdun » et « La Neuville », au sud de la courbure de la Somme, en aval de la confluence, puis la zone longeant la rue XXX
II – L’occupation actuelle
Environ la moitié des 250 hectares des hortillonnages sont voués à l’agriculture actuellement pratiquée par des professionnels et par des jardiniers amateurs.
1. L’agriculture professionnelle
a) Localisation (carte) :
Occupant la totalité du site jusqu’au début du XX ème siècle, le maraîchage a aujourd’hui disparu de certains secteurs (partie septentrionale par exemple). Il existe de façon éclatée le plus souvent, plutôt à la périphérie du site, plus facile d’accès, 3 zones se détachent nettement :
– au centre la zone de Camon : entre le Pré du Gouverneur Nord et la rive droite de la Somme
- à l’ouest, la zone du Malaquis à Rivery
- au sud, sud-est : le secteur de l’Agrappin et celui compris entre la rue de Verdun et la Somme.
b) La production et l’organisation de la profession :
Fidèles à leur réputation de « plus fameux jardiniers de tous les autres, de toutes les provinces de France » comme l’indiquait un chroniqueur du 17è siècle, les hortillons produisent une grande variété de légumes (une trentaine environ).
L’éventail des cultures dépend très souvent de la taille de l’exploitation et du mode de commercialisation pratiqué par le maraîcher.
Le marché sur l’eau qui se déroulait au Port d’Amont à Amiens, trois fois par semaine n’existe plus. Moins pittoresque un marché de gros l’a remplacé sur la zone industrielle en Longpré en 1976, et permet d’écouler une partie de la production. Néanmoins la majorité des maraîchers pratiquement encore en tout ou partie la vente directe aux particuliers .
Un Groupement d’Intérêt Economique (GIP) a bien été créé, en 1983, mais il est encore trop tôt pour apprécier l’impact de cette mesure.
c) Structure et taille des exploitations :
Depuis le début du siècle, le nombre de maraîchers n’a fait que de décroître : 1000 en 1900 ; 110 en 1950 ; 16 en 1980.
De taille souvent modeste, la moitié des exploitations ne dépassent pas 1 ha. Elles ont toujours un caractère familial . Un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) cependant fonctionne avec trois associés.
Plus de 50% de ces exploitants sont âgés de 50 ans ou plus. Ils ne désirent plus s’agrandir et parfois envisagent de restreindre leur activité.
En revanche se dégage une catégorie de maraîchers plus jeunes (moins de 40 ans) cultivant des superficies un peu plus grandes (1,5 ha parfois plus de 2 ha). Plus ambitieux, ils souhaitent s’agrandir, d’autant que leur avenir successoral paraît assuré.
Si les ¾ sont propriétaires des terres qu’ils exploitent, rares sont les exploitations dont les parcelles sont regroupées.
Enfin, une dizaine d’hectares sont utilisés par trois pépiniéristes.
Tableau croisant l’âge des maraîchers et la taille, les souhaits et le système de production des exploitants.
2 – Le jardinage
Il s’exerce partout sauf dans la partie est (Marais d’Hecquet) et dans la partie centrale du site (entre le rieu des Aulnois et le rieu de Creuse approximativement).
Pratiqué par des habitants riverains, des propriétaires ou locataires venus de l’agglomération, il relaie souvent l’activité maraîchère professionnelle.
Il n’est pas rare que les parcelles jardinées libèrent sur une part de leur superficie, un espace d’agrément.
C’est une activité importante (plus de 80 ha y sont consacrés), caractéristique des pratiques sociales locales, à la fois expression d’un besoin de détente active et fonction d’appoint économique pour nombre de familles.
L’ensemble de ces activités agricoles a nécessité la présence quasi-permanente de l’homme dans le site. Elles lui ont imposé des contraintes d’entretien des terres, des berges et des voies d’eau qui ont permis au site de subsister jusqu’à nos jours.
Oui, l’activité agricole, quel que soit le statut sous lequel elle s’exerce, est bien vitale pour la maintenance du site.
1 - L’urbanisation dans les hortillonnages
a) Les franges urbaines :
Pénétrant au cœur de la ville, les hortillonnages sont presque entièrement circonscrits par l’urbanisation.
A proximité du centre ville avec lequel ils étaient en relations économiques très étroites, ils se sont trouvés limités dans leur extension.
A l’ouest le fond de vallée est devenu après drainage par les canaux, un quartier d’habitations et d’industries utilisant l’eau : Saint-Leu.
La construction du boulevard Beauvillé à la fin du siècle dernier a introduit une très forte coupure dans le site par le haut talus de remblaiement qu’il constitue. Les seuls passages d’est en ouest qu’il ménage sont : la Somme, le Chemin de Halage, les bras du Baraban et la rue de l’Abbé de l’Epée. Ceci a facilité le développement de l’urbanisation de la rive droite de la Somme, contribuant à leur donner une place plus centrale dans l’agglomération.
A la suite de cette réalisation, les abords de l’étang Saint-Pierre ont été progressivement aménagés avec des équipements variés. L’édification du Parc Beauvillé (et peut-être un jour du rectorat), constitue une poursuite vers l’est du développement urbain dans le site et un renforcement de la coupure réalisée par le boulevard.
Au sud, le remblaiement de la partie comprise entre la rue Dejean et l’Avre, où s’est constituée une zone de dépôts, ainsi que l’extension de la petite zone industrielle de la rue de Verdun ont réduit sensiblement la superficie des hortillonnages sur la commune d’Amiens.
De même la trame ferroviaire a provoqué une césure importante dans leur développement sud-est, marquant fortement l’espace original formé par les vallées de la Somme et de l’Avre.
Au nord, les communes de Rivery et Camon se sont étendues le long des versants de la vallée de la Somme, accentuant ainsi le caractère linéaire du site.
Cette urbanisation périphérique cherche à s’infiltrer à l’intérieur du site :
- quelques pédoncules se branchent sur la voie qui longe la rive droite (à Rivery : l’Impasse Motte et l’Impasse Marcel)
- le Chemin de Halage est jalonné d’habitations sur quelques centaines de mètres.
Ainsi limitée par les franges urbaines à l’ouest, au nord et au sud, les hortillonnages ne présentent plus qu’une ouverture à l’est en continuité directe avec l’amont de la vallée de la Somme. Cette seule ouverture du site vers les écosystèmes voisins est d’une importance capitale pour le maintien et le développement des échanges et des équilibres biologiques des hortillonnages, d’où l’importance du choix du viaduc long qui permettra à la rocade est de franchir la vallée de la Somme entre Glisy et Camon, sans interrompre ces échanges.
Physiquement donc, par l’effet de l’urbanisation périphérique, les hortillonnages constituent un monde clos, une enclave verte, en plein centre de l’agglomération.
b) L’urbanisation interne du site (voir étude DDE-CAUE : « Architecture et paysage des hortillonnages, 1981) :
Par sa situation et la qualité de ses espaces le site exerce un attrait considérable sur les citadins en quête de détente.
Répondant à un besoin social, le développement d’un habitat de loisirs privé et individuel a été facilité par le déclin du maraîchage et l’évolution du mode de vie.
Ainsi a proliféré dans le site une multitude de constructions en tous genres, de la cabane à la maisonnette à usage de « résidence secondaire» ou « d’abris de jardin » illicites le plus souvent.
Utilisant les matériaux les plus variés, les couleurs, les formes, les styles les plus disparates, elles reflètent avec diversité et parfois fantaisie, l’expression de l’imagination individuelle libérée des procédures administratives et participent ainsi à l’originalité du site.
4. Les structures d’accueil
De tout temps le public a fréquenté les hortillonnages : dancing du Week-end, guinguette de l’île Robinson, piscines de l’ile aux Fagots et de « Fémina Sport » dont les vieux Amiénois conservent le souvenir.
Aujourd’hui disparus ces lieux de distraction ont cédé la place à des structures nouvelles de fonction différente : l’Ile aux Fagots remplit un rôle d’abord éducatif et pédagogique et l’embarcadère du « Week-end », point de départ des visites en bateau, un rôle touristique.
a) L’Ile aux Fagots :
Conscients de la qualité d’un tel patrimoine, les élus des communes d’Amiens, Camon, Rivery, regroupées en Syndicat (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et la Sauvegarde des Hortillonnages créé en 1977), décidèrent l’installation d’une structure d’accueil : « l’Ile aux Fagots » (1980).
Structure légère (bois) d’une architecture discrète, bien intégrée dans le site, le local sert de support à des activités pédagogiques :
- Pour le public scolaire, initiation à l’environnement et découverte du milieu humide.
- Etude de l’écosystème des hortillonnages pour un public de spécialistes
Ouvert à tout public, ce centre est le premier témoignage d’une valorisation réussie du site.
b) Le Week-end :
Pour répondre à l’attrait qu’un tel lieu exerce auprès du public, l’Association de Sauvegarde créée en 1975 par quelques précurseurs amoureux des hortillonnages, décidait d’organiser et d’encadrer des visites guidées dans une partie du site. Elle renouait ainsi avec une tradition : la fréquentation collective du site.
De l’embarcadère aménagé au « Week-end » partent ainsi chaque année plusieurs milliers de touristes qui découvrent avec satisfaction les hortillonnages. C’est aussi un moyen de promouvoir Amiens et sa région.
5. La friche ou les terres sans utilisation apparente :
A côté des secteurs de jardinage, de maraîchage ou d’agrément, existent des aires délaissées, sur lesquelles la nature a repris ses droits.
Ponctuelles à l’ouest et au centre, ces parcelles en « friche » sont plus nombreuses à l’est entre le Marais d’Hecquet et la route reliant Camon à Longueau. Dans ce secteur elles forment un ensemble « terre-eau » où la marque de l’homme est à peine perceptible. Fortement boisé cet espace plus sauvage constitue un refuge pour la faune, et un enclos favorable à la prolifération de la flore du marais.
Il participe à la diversité du paysage des hortillonnages et lui apporte le charme de la végétation luxuriante à l’état naturel.
6. Les paysages des hortillonnages (Carte p 19)
Ces divers modes d’occupation du sol produisent inévitablement une multitude de paysages, Le site est devenu un véritable « patchwork » coloré et étonnant d’entités paysagères très contrastées.
Les zones cultivées offrent un paysage de champ ouvert, parsemé d’arbres isolés, ou groupés en bouquets, qui en rompent la monotonie et d’où surgissent çà et là un hangar maraîcher ou un abri de jardin .
Dans la zone d’agrément au contraire la végétation foisonne, arbres, buissons, bosquets organisent l’intimité des lieux, dans un paysage bâti, fermé, isolé dans un dédale de rieux et d’étangs .
L’horizon s’ouvre à nouveau au « Pré du Gouverneur » et à l’étang de Clermont, vastes plans d’eau couverts de nénuphars parcourus de volatiles divers et autour desquels quelques huttes de chasse témoignent de la survivance de cette activité contestée.
Dissimulées parfois derrière d’épais rideaux d’arbres, comme au nord de Rivery, les franges urbaines réapparaissent à maints endroits, dévoilant l’envers du décor urbain, déroulant leurs cordons de maisons identiques des zones pavillonnaires de Camon par exemple.
III. Menaces sur le site
L’occupation du sol qui vient d’être brièvement décrite est le résultat d’une lente évolution amorcée au début du siècle et qui s’est accélérée à partir des années cinquante.
D’espace essentiellement maraîcher, les hortillonnages deviennent de plus en plus un espace polyvalent dans lequel s’interpénètrent maraîchage, jardinage, agrément, friche.
Cette diversification des fonctions engendre un certain nombre de nuisances compromettant l’intégrité du site dans sa qualité, déstabilise l’agriculture professionnelle par la spéculation foncière qui s’instaure et les conflits d’usage qui naissent. C’est donc son existence même qui est remise en cause en tant qu’espace subnaturel original et potentiel économique.
Aussi convient-il de rappeler les différents problèmes dont le règlement conditionne la préservation des hortillonnages.
1 - La déstabilisation de l’agriculture professionnelle et ses conséquences.
Le recul de l’agriculture professionnelle comporte de multiples causes.
Les légumes du Midi, de Bretagne et de Hollande, acheminés facilement sur le marché amiénois concurrencent les produits des hortillonnages qui arrivent à maturité plus tardivement et à des prix de revient comparables.
Les contraintes du milieu (accès insuffisants, parfois délicats ; mécanisation rendue difficile) s’ajoutent aux problèmes de structure des exploitations inadaptées aux nouvelles méthodes de culture (plein champ, serres chauffées).
L’absence d’une véritable organisation sur le plan technique et surtout commercial de la profession, représente un handicap certain.
L’urbanisation accélérée de l’agglomération amiénoise, en périphérie et à l’intérieur du site est un facteur de perturbation. Elle provoque parfois des conflits d’usage.
« La spéculation foncière » née de l’engouement du citadin pour ce site lacustre calme et verdoyant, en favorisant la hausse du prix des terrains, gêne souvent l’extension de l’exploitation maraîchère, ou l’installation de nouveaux maraîchers, rend difficile leur succession.
C’est donc un potentiel économique et une production réputée qui sont compromis.
2 - La maintenance physique du site menacée par :
a) Le recul de l’agriculture a une incidence sur la maintenance du site :
Les maraîchers par nécessité maintenaient les aires en rapportant les boues extraites des fossés et rieux curés. Chaque année, les berges étaient soigneusement reconstituées. La présence des maraîchers garantissait un entretien convenable des hortillonnages. Elle est relayée par celle des jardiniers amateurs aujourd’hui. Mais ceux-ci n’occupent plus qu’une partie du site.
b) Le développement de l’occupation ludique :
Les parcelles délaissées par l’agriculture sont progressivement réinvesties par des citadins qui les transforment en « jardins d’agrément » (pelouses, bosquets…).
Ce changement dans l’occupation du sol s’accompagne d’un changement de comportement des occupants eux-mêmes.
Venus pour se détendre, ces nouveaux résidants acceptent mal les contraintes d’entretien qu’impose le site.
La tentation est alors forte de réduire les charges de maintenance, en « bétonnant » les berges, en délaissant le curage des fossés.
Dans certains cas, la parcelle n’est plus fréquentée, ou ne l’est qu’occasionnellement selon une périodicité très variable ; c’est alors l’invasion des herbes et des broussailles et l’immersion lente des terres non rehaussées.
c) La prolifération des embarcations à moteur :
Elles ont remplacé les longues barques plates qui déambulaient paisiblement dans les rieux .
Le batillage créé par l’hélice des moteurs de bateaux naviguant plus vite, sape davantage les berges et favorise leur érosion.
3 - Les aspects de la pollution :
a) Pollution visuelle :
Le développement de l’usage d’agrément a entraîné la prolifération des constructions (maisonnettes, abris à outils, cabanons).
L’hétérogénéité de ce bâti est grande. Bien qu’il soit difficile de faire abstraction de sa propre subjectivité pour en apprécier la qualité, son impact visuel est néanmoins loin d’être négligeable. Ainsi, l’implantation en bordure d’étangs ou de rieux de constructions aux couleurs parfois trop voyantes, mal dissimulées par l’insuffisance d’arbres, renforce leur impact visuel. En outre bâties parfois sur fondations et bien entretenues, elles marquent une volonté de durer. Cette occupation se poursuit même dans l’eau avec un enchevêtrement de clôtures et de barbelés, symbole d’un sens aigu de la propriété.
La situation est parfois plus dommageable encore dans les paysages ouverts (ceux voués à la culture) où l’absence de végétation révèle plus facilement encore la présence des hangars et des cabanons. A cela, s’ajoute l’impact de la ceinture urbaine, particulièrement agressif dans la partie industrielle de la rue de Verdun
b) Pollution des eaux (voir étude SRAE et carte)
Elle a trois causes : l’urbanisation, les rivières Somme et Avre qui traversent les hortillonnages, le comportement des occupants eux-mêmes.
Enserrés dans l’étau urbain, les hortillonnages servent d’exutoire d’eaux pluviales et ménagères provenant des réseaux des communes périphériques. Souvent cette pollution est limitée aux endroits où ces rejets s’effectuent. Néanmoins son ampleur devient inquiétante au quartier de la Neuville à Amiens et en bordure de la rue de l’Aggrapin.
Pollution interne également provenant des occupants eux-mêmes qui rejettent négligeamment : débris, objets divers, fânes, herbes faucardées… Bien que limitée dans l’ensemble, cette pollution pourrait encore être atténuée si les usagers adoptaient un comportement plus responsable. .
Enfin les hortillonnages sont traversés par deux rivières la Somme et l’Avre qui elles-mêmes plus ou moins polluées, déversent leurs matières en suspension « aux points d’entrée » dans le site (étude SRAE et carte).
Malgré une pollution très localisée, la qualité des eaux demeure néanmoins satisfaisante. Mais ceci implique une vigilance et un travail constants.
Conclusion.
Monde clos, havre de verdure et de tranquillité, enclavé dans un univers citadin tumultueux, les hortillonnages représentent donc un potentiel économique et écologique exceptionnel, qui fait partie du patrimoine local, voire national.
A vocation essentiellement agricole à l’origine, ses fonctions se diversifient progressivement et donnent naissance à des paysages multiples qui en renforcent l’attrait.
D’espace de travail ils deviennent de plus en plus « un espace ludique ».
La lente métamorphose conduit à la disparition du maraîchage, à la fermeture du site par l’édification d’un véritable rempart de constructions et l’appropriation privée des terres et des eaux à des fins ludiques, ce qui engendre nuisances multiples et conflits d’usage.
Incontrôlée cette évolution signifierait probablement dégradation accélérée du site, dénaturation certaine.
Conscients de cette situation, les élus du syndicat intercommunal substituent au « laisser-faire – laisser-aller » une nouvelle dynamique, et dans le cadre du POS proposent de nouvelles perspectives d’évolution, un nouveau devenir des hortillonnages qui leur permettent de survivre tout en s’adaptant aux contingences et contraintes du monde moderne.
IV- Le devenir des hortillonnages : les choix
L’analyse de l’évolution du site, la connaissance de son état actuel et les problèmes recensés ont permis au Syndicat intercommunal d’opérer des choix et de dégager des priorités dans les diverses vocations auxquelles le site pourrait prétendre et de hiérarchiser les actions à entreprendre en fonction de l’urgence des problèmes à résoudre .
Ces orientations pourraient être résumées ainsi :
1. Sauvegarder cet écosystème
2. Maintenir mais également favoriser l’activité agricole
3. Faire connaître le site à partir de structures et d’actions à développer ou à créer.
1- Sauvegarder les hortillonnages :
a) Cela consiste d’abord à garder la spécificité du site c’est-à-dire :
- Préserver cette morphologie typique d’un parcellaire découpé par l’eau
- Faire en sorte qu’il demeure toujours un milieu où prédomine l’élément naturel et subnaturel.
Cela suppose la nécessaire présence humaine qui doit certes continuer de se manifester dans son activité la plus ancienne, l’agriculture, mais également être reconnue dans ses manifestations plus contemporaines : activités ludiques en particulier (cela n’exclut pas bien entendu que ces nouvelles formes d’occupation de sol s’opèrent en respectant les règles visant à garantir cette spécificité physique du site).
- Empêcher sa dénaturation par une urbanisation dense et excessive qui de la périphérie a tendance à progresser à l’intérieur du site.
- Faire en sorte que l’urbanisation interne, soit non seulement limitée mais aussi qu’elle ne se transforme pas en habitat résidentiel semi-permanent.
b) C’est aussi maintenir un niveau de qualité élevé de l’ensemble des éléments constituant les hortillonnages.
Différentes mesures le permettront :
- Améliorer la qualité architecturale des constructions en mettant à la disposition des pétitionnaires un cahier de recommandations architecturales (ce document est prêt depuis 1982 : il est distribué dans les mairies des communes concernées, au CAUE, à la DDE, au siège de l’Association de Sauvegarde).
- Lutter contre la pollution des eaux, un diagnostic sur la qualité actuelle des eaux a été établi. Les sources de leur pollution sont identifiées, les mécanismes en ont été cernés. Le Syndicat intercommunal a mis au point une stratégie de lutte contre celle-ci ; la phase expérimentale en est aux prémisses. Les hortillonnages ne deviendront pas le cloaque de l’agglomération amiénoise.
- Protéger les boisements par les différents rôles qu’ils jouent :
.rôle d’animation et de cloisonnement du paysage;
.rôle d’écran contre les nuisances visuelles sur les franges et dans les secteurs de paysages ouverts;
.agent de dépollution important dans l’épuration de l’air vicié de la ville proche;
-préserver la qualité de l’ambiance dans les hortillonnages ;
.en canalisant la pénétration du public, parce que la fragilité du milieu ne supporterait pas une fréquentation humaine anarchique et trop forte ;
.parce qu’une fréquentation « sauvage » excessive peut être source de conflit avec les riverains ;
.en renforçant la surveillance, pour éviter les exactions en tout genre : vitesse excessive, vols, dégradations ;
Rétrécissant comme une peau de chagrin au cours de l’histoire, les hortillonnages auraient pu être victimes d’un nouveau dépeçage, si certaines infrastructures routières, prévues pour faciliter les communications dans l’est de l’agglomération, avaient été réalisées. Lors de l’élaboration du SDAU, les élus n’ont pas retenu ces projets et les hortillonnages ne seront pas traversés par de nouvelles routes.
Rappelons enfin que les hortillonnages sont déjà inscrits à l’inventaire des sites pittoresques du département (A.M. du 4 avril 1972). (Cf. Carte)
On le voit : Sauvegarder ne veut pas dire figer.
2 La défense et la promotion de l’activité agricole
../...
a) La mise en place d’une politique foncière
Différents moyens y contribuent :
- Freiner la spéculation foncière en réaffirmant la vocation agricole des hortillonnages, traduite dans le POS par la délimitation d’un vaste secteur agricole (1/3 de la superficie totale (terre-eau) ou la moitié de superficie des terres) dans lequel seules seront autorisées les constructions agricoles professionnelles ou les abris de jardin. Une telle disposition est susceptible de limiter le mouvement inflationniste des prix de terrains. Les professionnels éviteront ainsi d’immobiliser leur capital dans l’achat du « foncier ». Des jeunes exploitants pourront aussi s’installer plus facilement.
Favoriser la restructuration des exploitations par le regroupement de parcelles (à partir de cessions ou d’échanges, de reconquête de terres en friches).
Ce volet fait intervenir les organismes agricoles publics ou para-publics :
La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’exploitation rurale) bénéficiaire d’un droit de préemption sur les parcelles supérieures ou égales à 50 ares a déjà rétrocédé des terres à quelques maraîchers.
Une OGAP (Opération groupée d’aménagement foncier) mise en place en 1984 complètera cette action de restructuration.
Mais le syndicat intercommunal accompagne également cette démarche en louant ou vendant des terres aux maraîchers.
L’amélioration des conditions matérielles d’exploitation :
Les contraintes physiques du site sont fortes. Il est impossible de les faire disparaître, mais elles peuvent être atténuées. Plusieurs actions y participent :
l’amélioration des accès au site (CF. Carte)
Par des travaux de viabilité sur ceux qui existent
Par la création de nouveaux accès (Malaquis, Pré du Gouverneur nord, rue de Verdun…)
Par la réalisation de parkings et d’embarcadères (Malaquis, Camon …)
L’entretien de la voie d’eau seul moyen de circulation (Cf. Carte statut juridique des cours d’eau)
La voie d’eau est le seul moyen de transports à l’intérieur des hortillonnages. Son entretien est donc vital pour les usagers du site et en particulier pour les maraîchers qui l’empruntent quotidiennement.
Il est en majeure partie assuré par « l’Association d’entretien des canaux des hortillonnages » créée par décret du 27 janvier 1902, qui faucarde et cure 17 à 18 km de rieux (dont 1/3 par an).
Dans le financement de cette association, la part du syndicat intercommunal n’a cessé de croître ces dernières années.
C - la promotion de l’activité agricole
La qualité de la production n’a jamais été démentie. Sa renommée est y intacte .
Mais l’absence d’organisation de la profession empêche une politique de commercialisation d’envergure et donc limite la valorisation de cette production.
A ce jour, les efforts de regroupement en coopérative maraîchère n’ont pas abouti.
Cependant, la fête annuelle du marché sur l’eau lancée depuis trois ans, représente une opération publicitaire importante qui participe à la promotion, de la production hortillonne. La tenue d’un marché hebdomadaire au Port d’Amont à Amiens connaît une fréquentation satisfaisante.
D’autres initiatives pourraient accompagner cet effort de promotion : pourquoi pas un autre marché aux légumes, au port à fumier de Camon ?
2- Faire connaître les hortillonnages
a) Par le développement ou l’amélioration des structures d’accueil
Patrimoine local dont l’intérêt a été démontré, les hortillonnages méritent d’être davantage connus : ils doivent pouvoir être visités par les habitants locaux mais aussi les touristes.
Cette connaissance du site intéresse deux types de public.
« Le Grand public » d’abord peut et pourra encore en découvrir les multiples facettes par des visites guidées organisées à l’embarcadère du Week-end, par l’Association de sauvegarde des hortillonnages.
Mises en place depuis plusieurs années, ces visites drainent plusieurs milliers de touristes par an (10 000 en 1983, d’avril à octobre).
Bien canalisée, cette fréquentation ne pose pas de problème majeur : les circuits traversent peu de zones agricoles, souvent des zones d’agrément irriguées par des rieux larges et « profonds » ;
Circulant à vitesse limitée, les embarcations dirigées par des bateliers expérimentés ne provoquent pratiquement de dommages aux berges et aux parcelles.
Cette exploitation touristique représente une valorisation du site et contribue à étendre toujours plus loin sa réputation.
Mais la valeur de cet écosystème, sa place dans l’agglomération méritait qu’on en tire également parti en permettant à un public spécifique de l’appréhender et ce, dans de bonnes conditions.
Aussi, le Syndicat intercommunal a-t-il entrepris la création de « l’île aux Fagots » :
Cette structure d’accueil réalisée sur les ruines d’une ancienne piscine, sert de support à diverses activités pédagogiques. Là, de nombreux jeunes scolaires viennent chaque année s’initier à l’Environnement, sous la conduite de leurs professeurs, aidés par l’animateur du centre spécialisé en biologie végétale et animale. Dans ce laboratoire mis à leur disposition, des scientifiques peuvent également entreprendre ou développer des études sur ce milieu particulier.
Cette volonté de « non fermeture au public » favorise donc des initiatives complémentaires valorisantes et s’oppose à une fréquentation anarchique et sauvage que les élus n’ont pas souhaité.
La réservation d’une parcelle située en face de cette structure permettra aux élèves de
Livrer à des expériences culturales (Cf. Emplacement réservé).
L’accès envisagé reliera l’île aux Fagots au Chemin du Malaquis.
b) Par différentes mesures plus ponctuelles comme :
L’ouverture de « fenêtres » sur les hortillonnages, à leur périphérie (les abords du Pré du Gouverneur nord ont été aménagées). Une passerelle reliant l’ile Robinspn au Chemin de Halage, permet ainsi de pénétrer au cœur des hortillonnages, par voie terrestre. D’autres sont à maintenir (au Malaquis) ou à créer.
Rendre les pénétrations terrestres à la circulation piétonne : le Chemin de Halage par exemple sera aménagé pour qu’il devienne un lieu de promenade agréable et tranquille.
Améliorer les accès au site (Cf. carte)
Remettre en état des accès existants (routes, impasses, embarcadères…) ou en créer d’autres (comme au Pré du Gouverneur nord ou l’Impasse Marcel à Rivery).
Enfin, une « Maison des Hortillonnages » contribuerait aussi à faire connaître le site. Sorte de petit musée d’arts et de traditions populaires, installé près de la cathédrale ou de la Place Parmentier, tout en participant à l’animation du centre ville ancien, elle symboliserait l’existence de ce vaste patrimoine culturel et constituerait un jalon qui guiderait le touriste de la cathédrale aux hortillonnages, en passant par Saint-Leu.
Face à une métamorphose dont ils auraient pu être victimes, les hortillonnages ont suscité chez les élus, mais aussi les habitants une prise de conscience suffisante pour qu’on puisse affirmer aujourd’hui, que bien que constamment menacés, ils ne sont plus en danger.
V – Cohérence du P.O.S. avec les objectifs :
Les objectifs définis ont été traduits graphiquement au POS par un découpage qui privilégie les zones naturelles (NC en particulier) et des dispositions réglementaires les plus adaptées possibles aux orientations retenues.
Le découpage en zones
Ainsi peut-on distinguer deux types de zones dans les hortillonnages :
a)Une zone urbaine qui reprend l’ensemble des franges urbaines desservies et qui en fonction de la morphologie du tissu bâti se décompose en zones UA, UB, UC
Caractéristiques de ces zones urbaines
Selon le secteur des hortillonnages qu’elles bordent, elles portent la lettre « m » pour les zones riveraines des secteurs maraîchers et « l » pour les zones riveraines des secteurs d’agrément.
Elles comportent toutes une zone « tampon » séparant la partie terrestre urbaine des hortillonnages proprement dit, représentée par la trame « zone de culture à protéger en zone U » au zonage du POS.
Cette bande tampon inconstructible à usage d’habitation est instaurée pour arrêter la pénétration de l’urbanisation à l’intérieur du site.
Complètement non aedificandi en zone U1, elle n’autorise dans les zones Um que les bâtiments liés à l’exploitation agricole professionnelle.
b) Des zones naturelles : l’originalité et la qualité du site justifient l’importance accordée aux zones naturelles : NBh, NCm, NDl, NDn.
1 La zone NBh
Elle circonscrit l’urbanisation qui s’est développée dans des conditions de desserte très insuffisantes (en voierie, en réseau), le long des axes de pénétration à l’intérieur du site (Chemin de Malaquis et surtout Chemin de Halage).
L’insuffisance de viabilité, le caractère illicite de ces constructions, l’insertion de cet habitat ...

Un simple clic sur CONTACT *
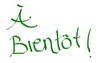
Dernière mise à jour de cette page :